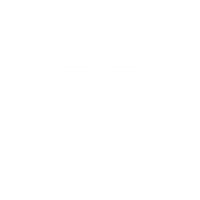📌Comprendre le droit de grève : un équilibre entre liberté et encadrement
La rentrée sociale 2025 est marquée par de nouveaux appels à la grève, notamment le mouvement du 18 septembre. Mais qu’entend-on juridiquement par « grève » et comment ce droit est-il encadré ?
Le droit de grève est consacré au plus haut niveau : al. 7 du Préambule de la Constitution de 1946. Il s’inscrit aux côtés d’autres libertés publiques comme la liberté d’expression (art. 11 DDHC), la liberté de réunion (art. 11 CEDH) ou encore la liberté de manifestation (Cons. Constit., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC).
👉 Qui peut faire grève ?
Il s’agit d’un droit réservé aux salariés, du public comme du privé. Les étudiants, professions libérales ou commerçants ne sont pas concernés, même si certains travailleurs bénéficient de régimes proches (ex. travailleurs de plateformes : art. L. 7342-5 C. trav.).
👉 Qu’est-ce qu’une grève ?
La Cour de cassation en fixe les critères (Soc. 5 nov. 1992, n° 90-41.899 ; Soc. 30 mars 2015, n° 14-11.077) :
un arrêt total du travail (pas de ralentissement ou de sabotage) ;
une action collective (sauf exceptions : salarié unique, mot d’ordre national, préavis dans un service public) ;
des revendications professionnelles (emploi, conditions de travail, garanties sociales) ;
la connaissance des revendications par l’employeur, au plus tard au début du mouvement.
👉 Quel rôle pour les syndicats ?
La grève est un droit individuel exercé collectivement : l’appel syndical n’est pas obligatoire, même si, en pratique, il structure la mobilisation. Dans les services publics, un préavis de 5 jours francs est imposé, déposé par un syndicat représentatif (Cons. Constit., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC).
👉 Quelle protection pour les grévistes ?
Le salarié gréviste ne peut être ni licencié, ni sanctionné pour sa participation (art. L. 2511-1 et L. 1132-2 C. trav.). Seule la faute lourde, démontrant une « intention de nuire » (Soc. 8 févr. 2012, n° 10-14.083), peut justifier un licenciement – et encore, la jurisprudence l’admet rarement (séquestrations : Soc. 2 juill. 2014, n° 13-12.562 ; violences : Soc. 26 mai 2004, n° 02-40.395).
Attention toutefois : pendant la grève, le contrat est suspendu, donc pas de salaire ni de couverture accidents du travail.
👉 Quels abus possibles ?
Une simple désorganisation de l’entreprise n’est pas suffisante pour limiter la grève (Soc. 14 janv. 1987, n° 84-40.945). L’abus reste l’exception.
🔎 En résumé : le droit de grève est un pilier du droit du travail français. Il protège fortement les salariés, mais il est encadré par des critères précis pour garantir à la fois l’expression des revendications et la préservation de l’intérêt général.
Source : Legifrance.gouv.fr